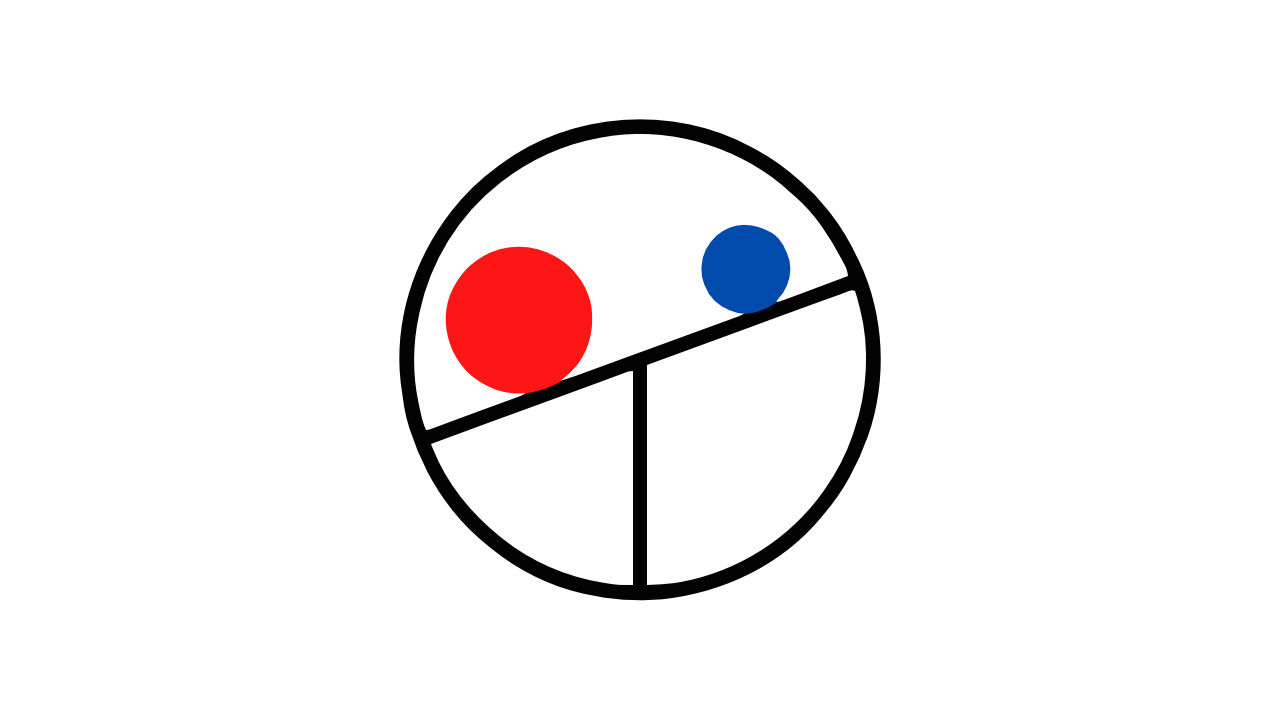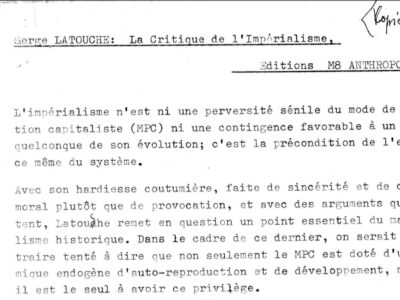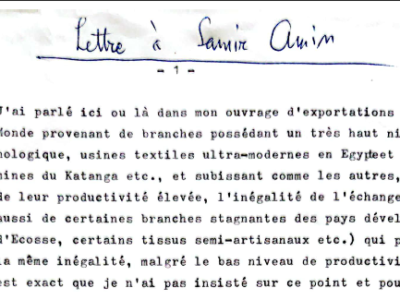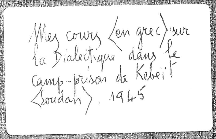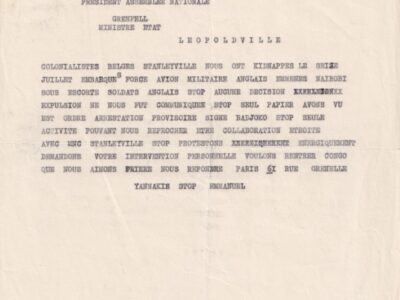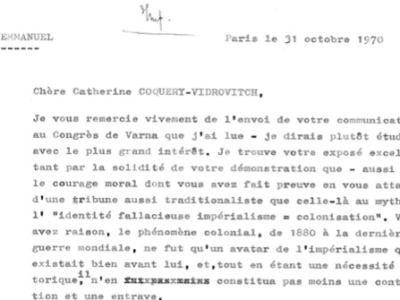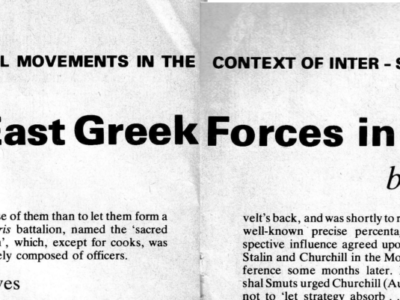Download as PDF.
Une des objections les plus réitérées lors de la discussion sur l’échange inégal a été celle qui se réfère à la notion de l’exploitation et à l’usage qui apparaît dans mon ouvrage.
Cette objection a généralement revêtu une double forme : d’une part, il a été soutenu que tout emploi “exploitation” en dehors de l’achat de la force de travail serait antiscientifique et “idéologique”; d’autre part, on faisait remarquer qu’un système de prix de production, dans la mesure même où il serait correct, c’est-à-dire épurer des carences bien connu du schéma de transformation de Marx, rendrait impossible l’appréhension logique du mécanisme et du taux d’exploitation.
Je me propose de montrer ici que les deux pans de cette objection sont mal fondés.
LE SENS DU TERME “EXPLOITATION” DANS LA THÉORIE MARXISTE
Dans la mesure où Marx lui-même est un bon marxiste, on peut affirmer sans risque de se tromper que la littérature marxiste n’a en aucune façon limité l’usage du terme “exploitation” dans le seul cas de l’achat de la force de travail. Pour s’en convaincre il suffit de glaner au hasard quelques-uns parmi les innombrables passages où Marx applique carrément ce terme à des faits et gestes, les plus variés et les plus éloignées des rapports entre employeurs et salariés. Ainsi par exemple:
“L’exploitation sous forme de pillage des hommes, l’esclavage, le commerce des esclaves et le travail forcé de ceux-ci, l’accroissement de ces machines de travail, sur produit producteur de machine, tout cela est alors à qui par la violence, cependant que le capital développé l’obtient grâce à l’échange.” (FONDEMENTS, Ed. Anthropos, Vol.II, p.300)
Par ailleurs:
“Deux nations peuvent procéder entre elles à des échanges d’après la loi du profit, de telle sorte qu’elle y gagne toutes deux, bien que l’une exploite et vole constamment l’autre.” (idem, p.426)
Et quelques lignes plus loin, il explicite cette thèse en définissant en quelque sorte l’exploitation par l’appropriation du surtravail et en indiquant formellement que cette appropriation peut avoir lieu en dehors de l’achat de la force de travail par le capitaliste:
“L’un des échangistes peut sans cesse s’approprier une fraction du surtravail de l’autre, sans lui donner quoi que ce soit en retour pour elle, et pourtant la mesure employée ici n’est pas celle de l’échange entre capitalistes et ouvriers.” (idem)
Aussi:
“En exploitant le marché mondial, la bourgeoisie a donné une forme cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays.” (Manifeste communiste, Pléiade, I, p.165)
Dans le deuxième chapitre du troisième livre du capital, Marx, parlant des formes precapitalistes de rente et notamment de la rente en travail (corvée), écrit:
“Si la force de travail est peu productive, c’est les conditions naturelles du travail sont insuffisantes, le surtravail est réduit, mais on peut en dire autant des besoins des producteurs, du nombre relatif des exploiteurs et enfin de se reproduire réaliser par le petit nombre des propriétaires qui se livrent à l’exploitation du surtravail.”1 (Pléiade, II, p.1402)
Comme s’il prévoyait l’erreur d’une interprétation par trop étroite, Marx multiplie les exemples ou l’exploitation dépasse le cadre du mode de production capitaliste:
“En ce sens le monopole de la propriété foncière est une condition historique préalable qui reste la base permanente du mode capitaliste de production, comme de tous les modes antérieurs de production reposant sur l’exploitation des masses sous une forme ou sous l’autre.” (Le Capital, Livre 3, Pléiade II, p.1271)
“Endetté le maître d’esclaves ou le seigneur féodal pressure davantage ses victimes… ou bien il finit par céder la place à l’usurier, qui devient lui-même propriétaire foncier ou possesseur d’esclaves, tel le chevalier de la Rome antique. A l’ancien exploiteur qui employait des méthodes plus ou moins patriarcales… se substitue un parvenu dur et cupide. Mais le mode de production comme tel n’est en rien changé.” (idem p.1270)
“Au Moyen-âge… la campagne exploite politiquement la ville ; mais économiquement, c’est invariablement la ville qui exploite la campagne par ses prix de monopole, ses impôts, ses corporations, trop de commercial et son usure.” (idem p.1411)
Mais même au sein du mode capitaliste de production, l’exploitation dépasse aux yeux de Marx le cadre de la production et du rapport employeur-salarié:
“À coup sûr, dans cette forme aussi “(prête à la consommation)”, la classe ouvrière est escroquée d’incroyable façon ; mais elle est également par le détaillant qui lui fournit les denrées. c’est une exploitation secondaire qui va de pair avec l’exploitation initiale, celle qui se situe au sein même du processus de production…” (Le Capital, Livre 3, Pléiade II, pp 1282-83)
“L’usure et le commerce exploite un mode de production donné.” (idem p.1283)
etc. etc.
A ces citations on pourra ajouter les deux passages bien connus, respectivement d’Engels et Lénine:
“Le prolétariat anglais devient de plus en plus bourgeois de sorte que cette nation qui est la plus bourgeoise des nations tend apparemment à acquérir une aristocratie bourgeoise et un prolétariat bourgeois parallèlement à la bourgeoisie proprement dite. Pour une nation qui exploite le monde entier, cela, naturellement, est dans une certaine mesure compréhensible.” (Lettre d’Engels à Marx, 7.10.1858)
“… Saurons-nous tenir… jusqu’au jour où les pays capitalistes d’Europe occidentale auront tache fait leur développement vers le socialisme ? mais il ne l’achève pas comme nous le pensions auparavant. il l’achève non par une “maturation” régulière du socialisme chez eux, mais au prix de lexploitation de certains états par d’autres, de l’exploitation du premier état vaincu dans la guerre impérialiste, exploitation jointe à celle de tout l’Orient.” (Mieux vaut moins mais mieux, 1923, Lénine, Œuvres Complètes, T.33, pp. 514-515)
Il ne semble donc pas que Marx et les classiques du marxisme et jamais voulu doter ce terme d’un caractère scientifique quelconque. Depuis l’achat de la force de travail par le capitaliste jusqu’au commerce international, en passant par les rapports au village-campagne, les activités du propriétaire foncier, celles de l’usurier, du commerçant etc., et l’employé dans le même sens général que celui de tout le monde: obtention d’un avantage indu au détriment d’autrui; l’achat de la force de travail n’en est qu’un cas d’espèce.
Ainsi défini, ce vocable constitution contestablement un terme normatif et c’est bien comme tel qu’il apparaît dans la littérature marxiste traditionnelle. il serait d’ailleurs impensable que Marx empruntât un mot si commun, c’est consacré par l’usage et si chargé d’idéologie pour en faire un concept scientifique moyennant une définition restrictive, celle qui limite son application au cas particulier de l’achat de la force de travail, définition qui, au demeurant, ne figure nulle part dans l’œuvre marxienne. Ajoutons en passant que si tel était la définition du mot “exploitation”, expressions telles que “exploitation du travail”, “exploitation de la force de travail”, etc., que Marc c’est les marxiste en mille fois utilisé serait d’affreux pléonasmes. 2
Ce qui peut avoir une connotation scientifique c’est le “degré” ou le “taux” d’exploitation, ne fût-ce que parce qu’il implique l’existence d’une mesure. Mais il ne s’agit alors que d’une transposition littéraire du “taux de plus-value”. Comme elle n’y ajoute rien sur le plan scientifique, cette expression devient alors inutile; taux de plus-value suffit.
Mes critiques résonnent comme s’ils craignaient que mes lecteurs ne soient induits en erreur. Quand les gens par exemple dans mes écrits que la nation française où les ouvriers français exploite la nation sénégalaise nom des disques que les ouvriers français achètent la force du travail des ouvriers sénégalais! Naturellement, cette crainte ne m’a pas effleuré, pas plus qu’elle n’a effleuré Marx, Engels, Lénine, Otto Bauer etc., quand ils écrivaient la même chose. Après tout, si les mots, exploiter, exploitation, sont imprimés 20 fois dans mon livre, ils font plus de 10 fois partie de citations de l’un ou l’autre de ces auteurs.
En fait, même lorsque Marx a plus que le mot exploitation au cas de l’achat de la force de travail, ce que ça me recouvre n’est pas l’acte de l’achat proprement dit, mais la propriation du surtravail qui en dérive et dans la mesure où il en dérive, puisque le degré d’exploitation est fonction de la quantité de ce surtravail. Selon Marx, ce taux d’exploitation est variable conjoncturellement. Rien n’empêche donc que dans certaines circonstances il soit zéro. Dès lors, c’est la seule chose qui méritait le nom d’exploitation était l’achat de la force de travail on devait conclure qu’il peut y avoir exploitation à un degré zéro!
Mais si personne n’achète de la force de travail qu’en vue de s’approprier une partie au moins du surtravail, on peut par contre très bien s’approprier du surtravail sans qu’on soit soi-même acheteur de force de travail.3
Le contenu de l’exploitation ainsi précisé, je n’ai aucun malentendu à craindre de la part de mes lecteurs. Car c’est bien dans ce sens, c’est-à-dire dans celui de l’appropriation de surtravail que j’emploie ce terme. Quand je dis que les travailleurs des pays développés participent à l’exploitation de ceux du tiers-monde, je n’entends pas qu’en travaillant 8h c’est travailleur touche l’équivalent de 6 ou 7 heures alors que ceux du tiers monde, pour le même nombre d’heures total, n’en touchent que deux ou trois, mais qu’en travaillant 8h il touche l’équivalent de plus de 8 heures, peut-être de 18 ou de 28, le surplus ne pouvant, de toute évidence, être autre chose que du surtravail de quelqu’un, en l’occurrence, celui des travailleurs du tiers-monde. si j’ai raison ou tard quand au fond, c’est une autre question, qui ne peut en aucun cas être de conceptualisation mais de calcul.
LE PROFIL ET L’EXPLOITATION DANS UN SYSTÈME DE PRIX DE PRODUCTION
Un certains consensus s’est dernièrement établi parmi les marxistes sur l’idée que la soi-disant “transformation” constitue un problème insoluble, aucune transition logique ne pouvant exister entre des valeurs absolues exprimant des quantités de travail physiquement donné et les prix de production relatifs exprimant de simple rapport d’échange entre les marchandises, ces rapports fussent-ils normalisés.
Le désaccord commence au-delà de ce point. D’un côté l’on pense que cette irréductibilité de la valeur au prix de production n’empêche pas que le rôle essentiel de tous les deux soit d’expliquer les échanges, chacun dans des conditions, historiquement ou hypothétiquement–peu importe–différentes. C’est aussi mon opinion personnelle. De l’autre côté, elle en acerbe que seul le prix de production détermine et équilibre les échanges, alors que le rôle exclusif de la valeur travail, beaucoup plus noble celui-là, et de rationaliser l’existence même de la marchandise, avec, dans un deuxième temps, l’explication du profit et de l’exploitation.
Ainsi les rôles seraient partagés. La valeur travail ne montrerait l’exploitation mais n’aurait rien à voir avec les échanges, elle semblerait même les contredire ; le prix de production, lui, expliquerait bien les échanges mais occulterait l’exploitation.
Cette position nous semble inacceptable.
Si les valeurs des inputs sont transformées en prix de production en même temps que celles des outputs, disent en substance ceux qui formulent cet argument, si le système de prix de production, hybride et boiteux, de Marx est remplacé par un système de prix de production intégrale et partant correct, type Sraffa, toute trace de l’origine et de la nature du profit disparaît. Avec un tel système on rend parfaitement compte des échanges mais l’on se prive de tout moyen de montrer l’exploitation. Quant à la conception qui inscrit la rupture entre valeur et prix de production dans une séquence historique, faisant de l’une le déterminant des échanges dans les rapports marchands simples et de l’autre celui des échanges dans le mode de production capitaliste, conception qui chez Engels, fait remonter la valeur travail à plusieurs milliers d’années dans le passé, l’attitude de ces théoriciens va du simple sarcasme à l’affirmation que les rapports marchands simples ne sont généraux ou dominants dans aucun système de production.
Ces derniers oublient que les quantités de travail socialement nécessaire déterminent effectivement l’échange des marchandises non seulement dans les rapports marchands simples mais aussi dans les systèmes capitalistes peu développés où le capital, prisonnier de son affectation première, est difficilement transférable de branche à branche.4 Or si les premiers ont plus ou moins une vue de l’esprit, eux, ont bien une réalité historique.
Ils oublient aussi qu’Engels n’est pas le seul à avoir exprimé une telle idée. En termes un peu plus modérés, Marx a écrit exactement la même chose.5 Mais il est de mise actuellement de tenir aucun compte de certains passages marxiens quand il s’agit de sauver Marx contre lui-même. C’est une forme moderne de dogmatisme. De même que dans toute chose il existerait très dialectiquement dans Marx un (+) et un (-) ; la fidélité inconditionnelle va jusqu’à essayer d’accroître le (+) par élimination du (-).
La valeur et les valeurs d’échange
Mais il existe un ennui plus grave. Il n’y a aucun moyen de faire une théorie de la marchandise, c’est-à-dire d’expliquer la transformation des produits en marchandises, des valeurs d’usage en valeurs d’échange, sans s’intéresser aux échanges eux-mêmes et sans donner leur déterminant et leur mesure.
Car il ne s’agit pas de démontrer la simple possibilité abstraite de mensuration, de quantification. Point n’est besoin d’une théorie particulière pour cela. n’importe quoi dans l’univers et comment sera avec n’importe quoi moyennant certaines abstractions et certaines réductions. Il existe – pas un – mais une foule d’éléments communs dans les choses les plus dissemblables et les plus hétérogènes. Par conséquent, si vous vous bornez à démontrer la simple possibilité en soit d’une quelconque équivalence entre les choses qui reproduisent la vie et la société humaine, vous évitez toutes les contradictions mais vous n’avancez pas d’un pouce dans la voie du savoir.
Pour avancer, il vous faudra non seulement poser la commensurabilité, en tant que simple possibilité de transformation de la qualité en quantité, ce qui n’est que la simple constatation d’un fait, non seulement dire que la commensurabilité implique l’existence d’une substance commune, ce qui ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà, mais choisir une substance comme une parmi d’autres, une unité de mesure parmi toutes, une manière de quantifier parmi d’autres, et démontrer qu’elle est la bonne. La validité d’une théorie de la marchandise, c’est-à-dire d’une théorie de la quantification des produits du travail humain, est donc indissociable de la mesure choisie.
Or, les auteurs dont il s’agit raisonnent comme s’il pouvait y avoir une théorie de la valeur en dehors des valeurs d’échange des marchandises. Ils déclarent d’une part que la commensurabilité des marchandises implique que ces dernières doivent avoir une substance commune et que cette substance c’est le travail–en cela ils sont d’accord avec Marx. Mais ils affirment par ailleurs que le travail n’est dans aucun cas mesure de valeur et que la théorie de la valeur n’a rien à voir avec les valeurs d’échange des marchandises, ce qui contredit tous les longs développements de Marx dans les premiers chapitres du Capital.
Cela est d’ailleurs contradictoire en soi point car si le travail n’est pas mesure de valeur, même dans le cas où r = Ø, alors il n’est pas substance des marchandises non plus, puisque la seule chose qui a fondé dans notre esprit sa qualité de substance commune c’est justement le fait que les marchandises sont commensurables et que le travail nous est apparu comme le seul élément commun permettant cette commensurabilité, donc comme la seule mesure possible.
Dire que dans le système en valeurs l’exploitation est directement et clairement visible alors que dans le langage des prix de production elle devient illisible, c’est une pétition de principe des plus typiques. Nous ne voyons, nous ne lisons dans nos systèmes que ce que nous y avons mis nous-même.
Si, en réalité ou par hypothèse, le travail est l’unique facteur de production, ou si les autres facteurs de production, pour une raison pour une autre (et encore une fois en réalité au par hypothèse), ne comptent pas pour la répartition du produit, la part des non travailleurs étant proportionnelle à celle des travailleurs indépendamment du poids relatif des autres facteurs, alors les choses sont claires et l’exploitation saute aux yeux: autant d’heures pour soi-même, autant d’heures pour le capitalisme. Lorsque, par contre, les autres facteurs interviennent, tout s’embrouille et l’exploitation devient difficile à déchiffrer. Est-ce une raison pour dire que nous avons besoin du système en valeurs pour te montrer l’existence de l’exploitation?
Pas nécessairement. Les mythes sont généralement très clairs; les vérités, complexes et implacable. Condamner, peut-être l’avortement dans le cadre de la morale religieuse est une chose sûre et sans équivoque; c’est un interdit inconditionnel donné par révélation divine. Par contre, se prononcer pour ou contre l’avortement en terme de morale laïque, c’est une tâche ardu et incertaine. Cela ne démontre pas la révélation divine ni le bien fondé de l’interdit.
Si vraiment l’unique moyen dont nous disposons pour démontrer l’exploitation c’était la théorie de la valeur travail, si, par ailleurs, nous venions à admettre que cette théorie est une pure construction de l’esprit et qu’elle ne reflète aucun moment réel dans une séquence historique, si, enfin, il était exact qu’un système correct de prix de production exclu cette notion, alors nous ferions mieux de reconnaître tout de suite que l’ “exploitation” est indémontrable plutôt que d’insister à tourner en rond dans des spéculations ontologiques, comme nous sommes en train de le faire depuis déjà quelques années.
Mais ce n’est pas le cas. Tout dépend de la définition. Naturellement, si nous définissons l’exploitation par deux quantités homogènes de travail, respectivement payé et impayé, et son taux par le rapport de ces deux quantités, nous supprimons par avance toute possibilité de trouver ces choses-là ailleurs que dans un système en valeurs travail. Mais si nous définissons l’exploitation en terme de répartition du produit net de la société entre les travailleurs et les non travailleurs, il n’est plus nécessaire de remonter des prix de production aux valeurs pour la faire ressortir.
Cette répartition antagonique ressortirait encore plus clairement si nous abandonnons les deux simplifications majeures, aussi fortes qu’inutiles, de Sraffa, notamment:
- celle qu’il reprend de Marx, à savoir une vitesse de rotation uniformément égale à l’unité aussi bien des équipements fixes que du capital constant circulant, et
- celle qu’il a introduite lui-même, à savoir, que les salaires sont payés après la réalisation du produit et que leur montant ne compte par conséquent pas dans le capital engagé.
Ainsi, en symbolisant par , les quantités de
, constituant le capital fixe des branches
, alors que
représentent l’usure de ce même capital + le capital constant (matière première + matériaux auxiliaires), pour un an de production, le tout disponible au début de l’année, et en supposant que la somme annuelle des salaires doit être aussi disponible au début de l’année, nous remplacerons l’équation sraffienne,
par
À cette présentation directe de l’exploitation par les prix de production on a opposé deux arguments:
1) Que le capital (non travail) reçoive une part du produit social et que cela soit bien visible dans le système de prix de production ne suffit pas pour fonder l’existence de l’exploitation. Encore faut-il démontrer que le travail seul est productif. Or, Marx lui-même a formellement condamné une telle exclusive.6
Joan Robinson a déjà répondu à cette objection à peu près dans ces termes: le capital peut bien être productif, la propriété du capital, elle, ne constitue pour autant pas une activité productive. Cette réponse est adéquate. La rente différentielle est bien reconnue par le marxisme comme étant l’effet de la productivité inégale de la terre, cela ne justifie pas pour autant à ses yeux le droit du propriétaire foncier à s’approprier cette rente. 7 Qu’il y ait un seul facteur productif ou 1000, le seul facteur qui appartient à l’individu et que l’individu peut fournir à la société c’est le travail. Les autres facteurs, s’ils existent, appartiennent à et sont fournis par la collectivité. Il s’ensuit que l’homme exploite l’homme dès l’instant où il reçoit quelque chose sans contrepartie de travail, et l’existance d’autres facteurs, ainsi que leur contribution éventuelle à la production sociale, ne change rien à cette situation.
“Capital productif”, “capital-produit de l’abstinence” sont des choses qui met généralement mal à l’aise les marxistes. C’est un tort. Pour avoir voulu contester coûte que coûte ces affirmations, ils se sont mis dans une position de faiblesse dans leur discussion avec les néoclassiques. Je crois que la position juste est la suivante: le capital est productif mais le le fruit de cette productivité appartient comme le reste au travailleur. Le capital est en effet le produit de l’abstinence mais l’abstinence en question n’est pas celle des capitalistes. Il serait absurde de parler d’abstinence des capitalistes, alors que le plus abstinent d’entre eux consomme plus que le plus prodigue des travailleurs. C’est d’une part celle qui est imposée tous les jours au travailleur par le système du salariat; ce fut d’autre part l’abstinence forcée de ceux qui ont subi jadis l’accumulation primitive.
Il est bien entendu qu’ainsi posée l’exploitation est traitée en termes éthiques. Il n’y a rien là-dedans d’amoral. Comme nous l’avons déjà dit, de par sa nature, cette notion est éthique d’elle-même et la scientificité du marxisme n’y peut rien. Ce qui est scientifique dans le marxisme c’est uniquement la démonstration du caractère irréductible de l’antagonisme et partant la nécessité objective de la lutte des classes et de son accentuation continue jusqu’à la disparition finale des classes elles-mêmes.
Demander à un système de prix ou de valeurs de nous faire ressortir que le profit est le produit de l’exploitation n’a aucun sens. Tout dépend de nos postulats fondamentaux et de nos propres définitions. Ce qu’il faut et il suffit c’est que le système de prix nous montre que le salaire et le profit sont des composantes d’une grandeur donnée et qu’en tant que telles sont fonction décroissantes l’une de l’autre. Que par conséquent, dans des conditions de production données, aucune augmentation de salaire ne peut avoir lieu sans diminution du profit et vice-versa, qu’aucune amélioration de la condition d’une classe ne peut se faire qu’au détriment de celle d’une autre classe.
En somme, la question essentielle, comme l’a très bien vu Maurice Dobb est celle de savoir si la valeur du produit est formée par addition du profit au salaire, selon ce que certaines formulations d’Adam Smith et la doctrine néoclassique pourraient laisser supposer, ou si, au contraire, le profit est constitué par déduction du salaire de la valeur totale du produit, selon les formulations imparfaites et quelque peu vacillantes de Ricardo et celles, plus cohérentes et plus solides de Marx.
Si c’est la théorie de la déduction (selon le terme de Bortkiewicz) que nous choisissons, nous devons rechercher si un système correct de prix de production, par exemple type Sraffa, nous permet de saisir cette liaison fonctionnelle antagonique entre les deux pôles de la répartition.
2) Plusieurs arguments ont été avancés en vue de nier cette possibilité, mais celui qui condense et clarifie tous les autres se présente à peu près dans les termes suivants:
Les prix relatifs du produit social revenant à chaque classe sont des ensembles d’objets hétérogènes. Elles ne peuvent donc être comparées que par l’entreprise des prix relatifs. Mais les prix relatifs eux-mêmes dépendent de la répartition en termes de revenus monétaire. Il est donc impossible de mesurer ces parts avant les prix et l’on ne peut connaître les prix qu’après la fixation des parts. Il est donc impossible, non seulement de mesurer les parts ou leur rapport, mais aussi d’établir une liaison fonctionnelle entre elles.
La difficulté est réelle mais pas, comme le croient ces auteurs, insurmontable. Il est exact que dans un système de prix de production ce ne sont pas les parts du produit social qui sont, mathématiquement parlant, fonction décroissante l’une de l’autre, mais le salaire et le profit. Pour que cette liaison fonctionnelle puisse refléter un antagonisme irréductible entre les deux classes, il faudrait donc qu’à toute variation du salaire monétaire correspondit une inégalité des agrégats de biens-salaire consommés par le travailleur respectivement avant et après cette variation et que cette inégalité allât dans le même sens que la variation qu’il a provoquée. Il faudrait, comme le disent Benetti et Cartelier, qu’on puisse écrire une inégalité ratricielle entre les deux ensembles des éléments du salaire dans les deux versions. 8 Ce oui, bien entendu, leur semble impossible.
Or c’est effectivement ainsi que le problème se résout et le défit lancé par Benetti et Cartelier est bien impudent. Car, si 100 francs ou 100 marks ne signifient rien quant à la détermination d’un revenu,9 105 unités d’une monnaie quelconque représentent en termes physique et indépendamment des prix un pouvoir d’achat supérieur à celui qui est représenté par 100 de ces mêmes unités et c’est cela qui compte.
Comment les deux pouvoirs d’achat peuvent être comparés indépendamment des prix puisque leur contenu consiste en biens hétérogènes ? Ils le peuvent parce que le système des prix est tel que, toutes autres choses étant égales, aucun prix ne varie, par suite d’une variation des salaires, plus fort que le taux de cette variation même.
Écrivons un système de prix relatif:
Il s’agit de démontrer que .
Tous les éléments de la matrice des inputs matériels à gauche doivent être positifs ou nuls. Toutefois, il est clair que dans chaque équation-branche il doit y avoir au moins un élément, autre que l’output de la même branche, non nul. Sinon, notre système se disloque en plus d’un sous-systèmes parfaitement déterminé. Cette contrainte au plan mathématique formalise la condition posée par Sraffa, à savoir, que toutes les marchandises doivent être “fondamentales”, c’est-à-dire que chacune d’entre elles, (A, B,…,K) doit entrer directement ou indirectement dans la production de toutes les autres branches, donc directement au moins une des autres branches.
Il existe donc une diagonale élémentaire (minimale) qui doit obligatoirement se trouver au sein de n’importe quelle combinaison, les autres éléments de la combinaison pouvant être indifféremment positifs ou nuls et disposées dans un ordre quelconque autour de cette diagonale que voici:
éntant invariables et r variant en raison inverse de w, il s’ensuit que
ce qui entraine
ce qui entraine ⋮
ce qui entraine ⋮
ce qui entraine
Étant donné qu’aucun input ne peut être négatif, ses résultats n’est pas altéré si, à partir de la situation élémentaire ci-dessus, nous nous mettons à remplir l’une après l’autre les cases de la matrice avec des éléments non nuls.
Si aucun prix ne varie, notamment n’augmente, plus fort que le taux de l’augmentation du salaire qui a provoqué son élévation, il s’ensuit que le bénéficiaire de cette augmentation, par exemple de 100 à 105, s’il le veut, avec 105 unités de la marchandise-numéraire obtenir de chacun des biens qui constitue l’assortiment de sa consommation une quantité supérieure à 7 kg avec 100 de ces mêmes unités, à condition de ne pas dépasser certaines limites dans chacune des composantes de l’ensemble. S’il veut dépasser ses limites dans quelques-uns des biens de la collection, il devra subir un défaut dans les autres, mais, dans ce cas, le nouvel assortiment sera supérieur au précédent par le fait même de ce choix.
S’il y a deux biens, a et b, et si sa consommation avec 100 unités monétaires est , il pourra, avec 105 unités monétaires consommer
où
et
, et, par conséquent
.
Si à il préfière
où
, mais
, alors
, du fait de cette préférence et comme
il s’ensuit que
.
C’est cela qui donne un sens au revendications salariale avant les prix.
LE TAUX D’EXPLOITATION
Mais il est exact de dire que ce qui précède ne nous donne pas un taux d’exploitation. Si nous pouvons connaître le sens des variations réciproques des revenus et par conséquent montrer l’existence d’un antagonisme irréductible entre certaines catégories d’ayant droit, en revanche, nous ne pouvons, en aucun cas, les mesurer, ni en termes d’absolu ni en termes relatifs, puisque ce que les travailleurs et ce que les non travailleurs reçoivent à chaque instant sont incommensurables avant les prix, et les prix dépendent de ces deux quanta.
Commençons donc par nous demander à quoi nous servirait un tel taux. Quelle différence cela ferait-il de savoir que le “vrai” taux soit de 50 et non de 40 ou de 60% ? Pris isolement, quel sens ont ces chiffres? Avons-nous des raisons de croire, par exemple, qu’il existe un taux acceptable et un autre insupportable en soi?
D’abord, je trouve qu’il y a là un passage injustifié de la condition nécessaire à la condition suffisante. Pour que le taux d’exploitation ait un sens il faut mais il ne suffit pas qu’il soit indépendant des prix. Le rapport de poids des biens appropriés par les uns et par les autres est aussi indépendant des prix; il n’a pas de sens. Donc du fait que le rapport profits/salaires monétaires serait inacceptable parce que dépendant des prix il ne s’en suit pas que le rapport travail impayé/travail payé est, lui, acceptable parce que indépendant des prix.
Pourquoi ce dernier rapport serait significatif? Je ne vois qu’un seul cas, celui où nous voudrions savoir de combien la journée de travail serait réduite si, les techniques et le fond d’accumulation passée étant donnés, les capitalistes étaient supprimé et l’on décidait d’entrer dans une ère de reproduction simple en se contentant du niveau de consommation atteint par les travailleurs à la veille de la révolution.
C’est un renseignement dont le besoin risque de ne jamais se présenter. Si tant est que l’humanité révolutionnaire veut vraiment quantifier l’amélioration de son état par suite de la suppression de l’exploitation, ce ne sera pas en termes de réduction des heures de travail mais en termes d’augmentation de son bien-être matériel qu’elle cherchera à le faire, quand bien même elle aura, dans une certaine mesure et dans certains cas, à opter entre les loisirs et la consommation.
Travailler autant d’heures pour soi-même et autant d’heures pour le capitaliste n’est qu’une formule et, qui plus est, une formule qui peut induire en erreur si l’on n’y prend garde. Ce qu’on partage en réalité ce n’est pas la journée de travail mais son produit, et à l’encontre de la première qui est homogène le second ne l’est point. Car si, pour mesurer ce que l’homme donne à la société, le nombre de facteurs est indifférent, comme je le dis plus haut, dès lors que lui ne peut donner que son travail, ce nombre n’est pas du tout indifférent si nous voulons mesurer ce que l’homme reçoit de la société. L’apport de l’homme est simple : le coût social est composite. Alors si le capitaliste reçoit pour sa part une voiture dans laquelle sont incorporées 200 heures de travail et dont le prix est de 2000 dollars, et le travailleur reçoit x kilos de viande dans lesquels 1000 heures de travail sont incorporées et dont le prix est aussi de 2000 dollars, autant il est mal fondé de dire que le taux d’exploitation est de 100%, autant il est absurde de dire qu’il n’est que de 20%.
Tant qu’à faire, des deux rapports je préfère encore le premier qui reflète la réalité capitaliste, objet de notre étude, au second qui prétend refléter une réalité supérieure et qui la rate complètement. Il suffit de penser que toute élévation de la composition organique de la branche voitures fera baisser le taux d’exploitation, établi selon ce calcul, alors que ni le rapport des forces, ni les salaires nominal et réel, ni les appropriations réelles respectives ne seront nullement modifiées.
Mais, je le répète, aucun des deux rapports ne me semble utile en soi. Ce qui peut-être utile, ce sont les liaisons fonctionnelles de leurs variations. Or, je ne vois pas de théorème basé sur ces fonctions où les variations du rapport profits/salaires en monnaie ne feraient pas l’affaire.
Et après tout, est-ce que vraiment les heures de travail, fussent-elles du même individu, fournies dans les mêmes conditions et dans la même journée, sont vraiment plus homogènes que les agrégats de biens que cet individu consomme ? La septième ou la huitième heure de la journée représentent-elles la même dépense d’énergie vitale, la même spoliation du travailleur par le capitaliste, que la deuxième ou la troisième ? Qu’est-ce qui nous autorise à dire que 8h de travail sont le double de 4h et que par conséquent 4h de plus-value sur 8 heures de travail représentent un taux d’exploitation de 100% ?
- Ici aussi l’expression “exploitation du surtravail” n’a de sens que comme équivalent à”appropriation du surtravail”.↩︎
- Voir page 3, note… ci-dessus sur l’utilisation par Marx de l’expression: “exploitation dusurtravail”.↩︎
- C’est ce que Marx affirme explicitement dans les FONDEMENTS, cf. page 2 ci-dessus.↩︎
- En effet le producteur n’a dans ce cas aucune possibilité de grever son prix de vented’une rémunération proportionnelle à son capital, puisque le seul moyen dont il disposerait pour obliger le marché de lui reconnaître un tel renchérissement, celui de créer une pénurie en arrêtant ou en réduisant sa production et en transférence et capitaux dans une autre branche, lui fait justement défaut.↩︎
- “L’échange des marchandises à leur valeur ou à peu près, nécessite un degré de développement moindre que l’échange aux prix de production qui requiert un niveau déterminé de développement capitaliste… Même si l’on ne tient pas compte du fait que les prix et leurs mouvements sont dominés par la loi de la valeur, il est donc tout à fait conforme à la réalité de considérer que la valeur des marchandises précèdent, du point de vue non seulement théorique, mais aussi historique, leur prix de production. Ceci est valable pour les cas où les moyens de production appartiennent à l’ouvrier; ceci est le cas, dans le monde ancien comme dans le monde moderne, pour le paysan possédant son fond et cultivant lui-même et pour l’artisan. Ceci concorde également avec notre opinion émise précédemment, à savoir que la transformation des produits en marchandises résulte de l’échange entre différentes communautés et non pas entre membres d’une seule et même commune. Ce qui vaut pour ces conditions primitives vaut également pour les conditions ultérieures… aussi longtemps que les moyens de production immobilisés dans chaque branche ne peuvent être transférés que difficilement d’une branche à l’autre, et que, dans certaines limites, les différentes sortes de production se comportent entre elles comme le feraient des pays étrangers ou des communautés communistes.” (Livre III, Ed. Soc. T.VI, p.193 et suivantes. Souligné par Engels).↩︎
- (Cf. sa “Cririque du Programme de Gotha”.↩︎
- Remarquons aussi qu’il s’agit d’une question de terminologie. Si par “capital” nousentendons, non pas les moyens matériels de production mais le rapport social reflété dans la propriété juridique de ces moyens et contenant le “droit” de prélever une partie du produit de ses moyens, alors, au lieu de dire, comme Joan Robinson, que le capital est productif mais que la propriété du capital ne l’est pas, on dira que les équipements sont productifs mais que le capital ne l’est pas. Il est évident aussi que dans les deux cas, on entendra “productif” de valeurs d’usage, de richesses; on peut entendre “productif” de valeur, si, par définition, la valeur est une certaine quantité de travail.↩︎
- Cf. PROFIT ET EXPLOITATION: LE PROBLÈME DE LA TRANSFORMATION DES VALEURS EN PRIX, Papier ronéotypé, Séminaire Anthropos, 1972.↩︎
- Même si ces choses expriment une certaine quantité physique d’une certaine marchandise-numéraire (or), c’est-à-dire même si nous nous trouvons en régime de convertibilité absolue.↩︎